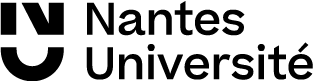Dispositif Etoiles Montantes - Les lauréats de Nantes Université
Ainsi, depuis 2019, 20 jeunes maîtres et maîtresses de conférence de Nantes Université ont bénéficié de ce soutien. Vous trouverez ci-dessous de courts résumés de leurs projet.
- En savoir plus : Mathilde LABBÉ
- Subvention régionale : 98 350 €
- Projet : SERÉLIT : Le catalogue Seghers ou la réinvention de l’édition littéraire (1944-2007)
- Résumé :
Pourquoi étudier un catalogue éditorial, une liste hétéroclite, moins littéraire et bien plus austère que les oeuvres qu’elle recense ? Parce que l’analyse des évolutions de cet objet pluriauctorial et plurigénérique est la meilleure façon de comprendre la dynamique d’une maison d’édition au-delà des apparences. Elle permet de dépasser l’architecture idéale postulée par le discours publicitaire éditorial, qui dissimule la cuisine, les renoncements, les substitutions d’auteurs et la façon dont les livres sont sortis de la ''marmite'' pour rejoindre les rayonnages de collections bien ordonnées. Si un catalogue éditorial se présente comme une somme d’ouvrages, c’est aussi l’inventaire d’un réseau et la trace d’un projet intellectuel et esthétique. Dans le cas des célèbres éditions Seghers, fondées en 1944, ce projet est si fortement articulé à l’histoire européenne que ce catalogue est également une excellente source pour une histoire politique de la littérature. Alors que la maison tout juste relancée redécouvre son fonds historique et que les recherches récentes font apparaître un essaimage mondial du modèle Seghers, le projet SERÉLIT propose d’analyser le catalogue 1944-2007, pour comprendre comment la maison a fait évoluer les modes de collaboration entre auteurs et éditeurs, reconfiguré l’histoire littéraire et transformé le paysage des institutions culturelles. Spécialiste de l’histoire du livre au XXe siècle et des phénomènes de patrimonialisation de la littérature, j’entends, avec le projet SERÉLIT, montrer comment une maison d’édition artisanale est parvenue à imposer, en France et à l’étranger, une nouvelle façon de faire circuler les textes, une nouvelle vision du patrimoine littéraire et une nouvelle conception du rôle politique et social de la poésie. Il s’agit aussi de comprendre le système de reconnaissance littéraire que l’éditeur a mis en place dans l’articulation des collections (critique amicale, cas d’auto-édition, maîtrise des mécanismes de consécration) et de mettre en lumière le rôle de nombreux collaborateurs jusqu’ici restés dans l’ombre du fondateur.
Le projet repose sur trois piliers :
- Exploiter des archives éditoriales jusqu’ici inaccessibles au public (archives EDITIS)
- Réaliser un inventaire de la correspondance de Seghers éditeur avec ses auteurs
- Constituer une base de données des sources disponibles pour l’étude de l’histoire des éditions Seghers.
SERÉLIT pose les bases d’une exploration de grande ampleur à poursuivre à l’échelle internationale et hors du livre, car cette activité éditoriale se prolonge par une participation active au mouvement de démocratisation culturelle du second XXe siècle. SERÉLIT permettra de comprendre la façon dont fonctionne un catalogue éditorial international mais aussi d’éclairer l’évolution du rôle social de la littérature à l’époque de sa spectacularisation et de faire apparaître l’articulation entre activité éditoriale et politiques culturelles.
- En savoir plus : Valentine REY
- Subvention régionale : 72 000 €
- Projet : SIRCOF - Simulation numérique robuste du contact frottant
- Résumé :
De nos jours, le comportement mécanique de très nombreuses structures (industrielles, bio-médicales, …) est simulé à l’aide d’outils numériques. Il s’agit de construire une représentation numérique de la structure ou de l'assemblage considéré dans un logiciel de conception assistée par ordinateur. Ces logiciels permettent ensuite la simulation de la réponse de la structure étudiée à des sollicitations définies par l'utilisateur. Ainsi, très tôt dans la phase de conception, il est possible de tester plusieurs configurations, géométries, matériaux sans recourir à des essais expérimentaux coûteux sur des prototypes. Si un contrôle qualité a été mis en place et que des mesures de la structures telle que fabriquée sont disponibles, celles-ci peuvent être incluses dans la maquette virtuelle créant ainsi un jumeau numérique. Lorsque la structure est en service, ces outils de simulation permettent d'optimiser le contrôle de santé de la structure et la maintenance. La mécanique du contact se trouve dans des applications diverses et variées : dans les assemblages telles que les boîtes de vitesse, dans les ouvrages d’art et structures du génie civil, dans les appareils bio-médicaux, ... Notons le développement récent et rapide des matériaux architecturés (souvent constitués d’un motif périodique de type treillis à l’échelle mesoscopique) obtenus par fabrication additive (grâce à une imprimante 3D par exemple). Ces nouveaux matériaux sont prometteurs car ils sont à la fois légers et résistants. Le contact sera nécessairement un phénomène présent lors de la simulation de chargements cycliques ou de modes de rupture de ces matériaux. On peut aussi citer l’essor des robots mous (robots non entièrement métalliques mais fabriqués à partir de silicone, polymères, caoutchouc, …) qui font preuve d’une meilleure adaptabilité, résilience et d’un coût moindre. De tels robots peuvent être utilisés en bio-médical ou pour l’automatisation industrielle. Ces robots mous ont un comportement plus complexe que les robots métalliques rigides. Or il est crucial de simuler avec précision ces comportements pour pouvoir piloter et contrôler les robots. Malgré de très grands progrès, la simulation des problèmes de contact avec frottement reste un enjeu à part entière : la géométrie de la surface de contact peut être complexe (rugueuse car composée de nombreuses aspérités), la recherche de la zone de contact est effectuée de manière itérative et peut être coûteuse en temps de calcul lorsque les deux solides sont déformables, des instabilités (alternance glissement/adhésion dans le cas de coefficient de frottement élevé) ou des phénomènes acoustiques induits par le frottement (crissement) peuvent également apparaître...
Ce projet vise à développer des méthodes numériques précises et robustes pour résoudre les problème de mécanique du contact avec coefficient de frottement élevé. Cela permettra de mieux simuler le contact frottant dans les structures ou les assemblages.
- En savoir plus : Gildas RATIÉ
- Subvention régionale : 140 000 €
- Projet : ISOCRUE : Devenir des métaux lors des crues extrêmes
- Résumé :
Les cycles biogéochimiques des métaux ont été profondément bouleversés par les activités anthropiques, particulièrement depuis la révolution industrielle. La croissance démographique et l’augmentation du niveau de vie ont pour conséquence une augmentation exponentielle des quantités de métaux extraits, tandis que les développements technologiques mènent à une diversification des métaux nécessaires au développement industriel, provoquant une augmentation sans précédent des rejets de métaux dans l’environnement. Ces activités ainsi que les impacts liés au forçage climatique sont à l'origine de flux et de mobilisation importants de métaux, notamment vers les sols et les eaux continentales. Au sein de la zone critique, les sols agissent tels des puits, notamment dans les zones humides présentant des capacités importantes de piégeage des métaux, agissant comme des filtres accumulateurs de par leur cycle hydrologique (hautes eaux/basses eaux) contrôlant les processus biogéochimiques. Les modèles climatiques prédisent que la fréquence, l’intensité et le nombre des épisodes de fortes précipitations vont aller croissant à mesure que le climat mondial évoluera. Cet état de fait ne permet plus de contraindre de façon précise le devenir et le bilan sources-puits des métaux dans la zone critique et par conséquent des apports globaux du continent vers les océans. Le questionnement du projet ISOCRUE repose sur le changement de comportement des zones humides vis-à-vis des métaux lors de crues extrêmes, pendant lesquelles les changements de conditions physicochimiques agissent comme déclencheur de processus qui transforment les zones humides, habituellement filtres accumulateurs de métaux, en sources secondaires de contamination. Afin de décoder la contribution des épisodes de crue sur ces bilans, je propose d’identifier des traceurs sensibles de l’origine de la matière organique, du fer et des métaux associés aux agrégats multiphasiques. En couplant les approches isotopiques et les techniques de spéciation solide, il sera possible d’identifier, dans les fractions exportées (dissoute, colloïdale et particulaire), les changements de spéciation et les processus de mobilité des métaux dans les zones humides. La double compétence isotopiespectroscopie est rare et originale, permettant de dresser des bilans depuis l’échelle moléculaire (spectroscopie des rayons X) jusqu'à celle du bassin versant (isotopie), pour déchiffrer les sources des métaux, et les mécanismes de sorption/désorption régulant leur comportement dans la zone critique. Ces résultats de recherche fondamentale sont essentiels pour répondre de façon pertinente à la préservation de services écosystémiques à travers les questions de la mobilité, de la toxicité et du devenir environnemental des métaux.
- En savoir plus : Camille AIT-YOUCEF
- Subvention régionale : 124 000 €
- Projet : AHIS-2MP : Approche historique de la régulation et de la microstructure des marchés dérivés de matières premières
- Résumé :
L'inflation est fortement dépendante du prix des matières premières. Il est donc important de s'interroger sur les déterminants de la formation des prix des matières premières pour mieux contrôler l'inflation. Le processus de financiarisation des marchés des matières premières , qui correspond à l'influence de l'activité financière sur la dynamique des prix, au cours des années 2000 a ravivé le débat séculaire sur le rôle de la spéculation. Ce débat précède largement la création des marchés financiers modernes, dont la naissance est souvent associée à la création du Chicago Board of Trade (CBOT) en 1848, mais ces derniers lui ont donné une toute autre dimension. Le bon fonctionnement de ces marchés peut dépendre de la régulation en place, des acteurs qui y participent ou de la microstructure de marché. La difficulté relative à l'étude du rôle de la spéculation ou d'une régulation particulière réside dans la disponibilité des données et la bonne identification des effets de chaque déterminant des prix. En effet, des chocs liés à des phénomènes complètement hétérogènes affectent les prix en permanence. Les archives du CBOT entreposées à la bibliothèque de Chicago contiennent non seulement des séries de prix de matières premières remontant jusqu'au 19ème siècle, mais aussi des données précieuses sur l'ensemble des règles et régulations qui ont régies le CBOT depuis sa création. L'objectif du projet AHIS-2MP est d'utiliser les données d'archives du CBOT jamais exploitées jusqu'à présent pour distinguer les effets de la régulation et de microstructures de marché sur les prix. Cette analyse est bien plus complexe à mener avec les données actuelles car il existe de nombreuses règles et institutions qui encadrent les marchés de matières premières, alors qu'en étudiant ces structures de marché depuis la fin du 19ème siècle, nous pouvons identifier précisément l'effet de chaque règle et institution sur les caractéristiques de marché.
- En savoir plus : Bertrand AUGIER
- Subvention régionale : 125 000 €
- Projet : CRRITIC : Crises de la République Romaine : Identités, Transformations, Imaginaires et Conflits
- Résumé :
Le projet CRRITIC est né de la volonté de proposer une vision alternative des dernières décennies de la période républicaine, entre crise gracquienne et bataille d'Actium (133-31 a.C.), loin d'une perspective téléologique la considérant comme menant inévitablement à la constitution d'un régime autocratique. Le terme de crise a souvent été convoqué pour analyser cette période, mais dans une perspective négligeant sa double dimension de révélateur et d'effecteur. En restituant toute leur importance aux multiples crises que connut la République romaine, en accordant une place centrale à l'événement, il s'agit de s'interroger sur les antagonismes qui parcouraient la cité, mais aussi sur ses capacités de transformation, donc sur les évolutions que connut Rome, alors en proie à des troubles qui dégénèrent en guerres civiles. Révélatrices, les crises sont aussi facteurs de transformations majeures, mettant au centre de la réflexion une conception plurielle de la res publica, en perpétuelle reconfiguration, tenant pleinement compte de la diversité des affaires, des acteurs sociaux et de leurs aspirations (sénat, peuple et magistrats mais aussi plèbe, armée, alliés, ...).
- En savoir plus : Lilian LACOURPAILLE
- Subvention régionale : 135 700 €
- Projet : QUADRATURE : Quantification de la charge interne musculaire pour la prévention et la rééducation des troubles musculosquelettiques
- Résumé :
-
En savoir plus : Ines ALBANDEA
-
Subvention régionale : 116 900 €
-
Projet : CoSoFT- Compétences sociales Formation et Travail
-
Résumé :
Le projet CoSoFT s’inscrit dans un contexte où les soft skills, compétences sociales ou encore savoir-être deviennent omniprésents dans les discours des employeurs et des recruteurs. Il ne suffit plus de valoriser ses compétences techniques lors d’un recrutement mais il convient également de mettre en avant son savoir-être dans son CV et lors d’entretiens d’embauche. On observe également un intérêt croissant de l’école et du système éducatif dans son ensemble pour ces compétences qualifiées de «non académiques» ou de transversales. Ce projet se compose de deux grands axes.
D’une part, l’objectif est de mettre en avant les compétences sociales valorisées par les employeurs. En dehors du diplôme et des compétences techniques que l’on associe également aux hard skills, quelles sont les qualités requises pour trouver un emploi ? Les soft skills recherchées par les employeurs dépendront du métier visé ou concerné, du profil de l’employeur, du contexte du marché du travail, etc. Ainsi, pour augmenter les chances de trouver un emploi, il convient d’identifier plus précisément les compétences que les individus doivent valoriser.
D’autre part, la définition de ces compétences fait l’objet de vifs débats. Peut-on parler de compétences ? Ne s’apparentent-elles pas davantage à des traits de personnalité ? Dans quelle mesure peut-on former les individus au développement de ces compétences ? Nous supposons que ces dernières sont principalement acquises dans la sphère familiale, ce qui nous amène à questionner l’importance croissante qui leur est donnée sous l’angle de la justice et des inégalités. En effet, contrairement aux compétences académiques, également valorisées lors d’un recrutement, les compétences sociales sont moins développées dans le système éducatif français. Ainsi, dans quelle mesure leur valorisation n’aggraverait-elle pas les inégalités sociales, en particulier sur le marché du travail ?
-
En savoir plus : Hamza BENNANI
-
Subvention régionale : 110 000 €
-
Projet : SEACC- La soutenabilité de la zone Euro face au changement climatique
-
Résumé :
Le changement climatique entraînera des conséquences hétérogènes, en termes d’anomalies de précipitations et de températures, dans les pays de la zone euro ces vingt prochaines années. Étant donné la relation entre le changement climatique et les prix des matières premières, ce phénomène induira différents chocs inflationnistes qui constitueront un défi pour l’efficacité de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) et par conséquent, pour la soutenabilité de la zone euro. Dans ce contexte, notre projet a pour objectif de fournir une vue d’ensemble des défis auxquels la zone euro fera face à la suite du changement climatique. Pour atteindre cet objectif, on simulera les projections des niveaux des prix dans les différents pays de la zone euro pour les vingt prochaines années, en nous basant sur les relations estimées entre les données climatiques et les données de prix des matières premières (Work Package 1). Dans une seconde étape, nous aurons recours à un regroupement hiérarchique pour regrouper les pays membres de la zone euro en clusters, en utilisant l’évolution des niveaux de prix comme critère de classification. Cette méthode nous permettra d’identifier plusieurs régions avec des dynamiques de prix similaires et donc, avec les mêmes besoins en termes de politique monétaire : des Zones Climatiques Optimales (ZCOs). Cette démarche fournira des éclairages sur le degré futur de (dés)intégration économique dans la zone euro. Finalement, pour mesurer la pression politique que la BCE est susceptible de subir, nous aurons recours au concept de stress monétaire pour chaque ZCO. Ce faisant, nous comparerons le taux d’intérêt de la BCE avec le taux d’intérêt contrefactuel qui devrait prévaloir dans une ZCO, compte tenu de sa dynamique future des prix. Cet indicateur de de stress permettra de quantifier le coût, en termes de taux d’emploi et de taux d’inflation, que les pays devraient subir compte tenu de leur appartenance à la zone euro.
-
En savoir plus : Valentin FLAUDIAS
-
Subvention régionale : 96 330 €
-
Projet : METABOU - Le « metacognitive hub model » du craving dans la boulimie et les troubles de l’hyperphagie boulimique
-
Résumé :
La boulimie nerveuse et l’hyperphagie boulimique sont des troubles très fréquents (environ 6% de la population) mais encore souvent mal compris. En particulier, la sensation d’ «envie impérieuse» et de l’incapacité de gérer des crises de frénésies alimentaires sont des facteurs régulièrement décrits par les patients. Ce projet vise à comprendre comment le lien entre les émotions, le contrôle de la pensée et les capacités de perception corporelle influent ces deux pathologies.
Le principal résultat attendu est l’observation de l’impact du craving dans la gravité de la pathologie (boulimie -BN- et d’hyperphagie boulimique - BED). Plus spécifiquement, nous nous attendons à observer des difficultés de gestions des émotions (Système émotionnel plus fortement activé et système de contrôle moins efficace) pour des patients en présence de stimuli alimentaires, que pour les personnes n’ayant pas de TCA. Cet effet serait modulé par les capacités d’intéroception de l’individu, ainsi que par ses capacités métacognitives (capacités à comprendre son propre fonctionnement cognitif).
Ces résultats vont montrer pour la première fois l’impact des processus psychologiques émotionnels, cognitifs et intéroceptifs sur le craving pour des patients souffrant de BN et de BED. A terme ces résultats permettront de fournir une évaluation complète et précise de ces dimensions, permettant de caractériser plus finement les difficultés de ces patients, et donc de leur traitement.
Des patients souffrant de BED et de BN seront recrutés dans les différents centres hospitaliers avec lesquels le candidat a l’habitude de travailler (Clermont-Ferrand, Montpellier, Nantes, Quebec ; et au besoin les centres TCA de la région Auvergne Rhône-Alpes). Un accord de principe est obtenu de la part de ces établissements. Le nombre de participants sera de 40 sujets souffrant de BED, 40 de boulimie et 80 témoins. Les critères d’inclusions seront de souffrir d’une des deux pathologies étudiées au sens du DSM 5 et l’absence de tout trouble psychiatrique pour la population témoin.
-
En savoir plus : Caroline DEVAUX
-
Subvention régionale : 37 800 €
-
Projet : SEAFLAG - Réguler le marché des pavillons de navire, entre défaillances et renouveau
-
Résumé : À l’aune de la crise sanitaire, le secteur maritime apparaît plus que jamais comme une activité essentielle. La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière l’importance de ce secteur aussi bien dans l’approvisionnement du pays que dans la mondialisation. Le transport maritime achemine en effet près de 90% des marchandises dans le monde. Ainsi, tant le commerce mondial que nos vies quotidiennes dépendent largement du secteur maritime. Pourtant, le transport maritime est aussi en proie à de virulentes critiques. De récents événements en août 2020, à commencer par l’explosion du port de Beyrouth, ou encore la marée noire à l’île Maurice provoqué par le navire MV Wakashio, ont marqué tous les esprits. Plusieurs États ont à cette occasion été pointés du doigt pour avoir autorisés la navigation de navires en mauvais état en dépit de leur dangerosité. Au-delà des drames humains et environnementaux engendrés, ces catastrophes mettent au grand jour l’existence d’un marché économique mondial derrière l’octroi d’une nationalité (appelée pavillon en droit maritime) à un navire et la présence de failles dans la régulation de ce marché. Dans cette optique, le projet SEAFLAG propose d’explorer le fonctionnement de ce marché mondial, dans le but de concevoir des solutions adaptées sur le plan juridique pour améliorer sa régulation. Le projet ambitionne notamment de répondre aux questions suivantes : Que représente le fait d’arborer un pavillon aujourd’hui pour les parties prenantes ? Quelles sont les dynamiques émergentes de ce marché globalisé des pavillons ? Comment améliorer les règles juridiques qui lui sont applicables et supprimer les failles du système juridique actuel ?
-
En savoir plus : Céline DUC
-
Subvention régionale : 121 897 €
-
Projet : M-EpiCC - Maintien de l’Epigénome au cours du Cycle Cellulaire : Etude des rôles des histones et de leurs protéines associées, chaperonnes et enzymes épigénétiques
-
Résumé : L’information épigénétique est portée par la chromatine constituée de protéines, les histones, autour desquelles s’enroule l’ADN. Le maintien de l’épigénome au cours du cycle cellulaire est permis par de nombreux mécanismes dont la compréhension est encore parcellaire. L’utilisation des cellules naturellement synchronisées du Blob combinée avec l’optogénétique pour contrôler l’expression de cibles est une approche de pointe et novatrice, qui permettra l’analyse de la dynamique des composants de l’épigénome. Des résultats préliminaires au laboratoire ont montré que tous les acteurs impliqués dans le maintien de l’épigénome sont présents et fortement conservés chez le Blob et un protocole de transgénèse du Blob a été mis au point, technique nécessaire à la réalisation de ce projet.
Le projet vise à étudier le maintien de l’épigénome via les isoformes d’histones H3 et d’une PTMs (modifications post-traductionnelles) au cours du cycle cellulaire. Des outils optogénétiques seront développés pour contrôler l’extinction de gènes cibles. L’utilisation de lignées optogénétiques produisant des aptamères d’ARN – oligonucléotides bloquant l’activité d’une enzyme épigénétique cibls – ou des shARNs permettant le silencing d’un gène de chaperonne d’H3 permettront d’évaluer les effets de la perte de ces acteurs sur l’épigénome pendant le cycle cellulaire. Une approche quantitative CUT&RUN associé à du séquençage permettra de dévoiler comment évolue l’épigénome au niveau des histones H3 (i) suite à l’extinction d’une isoforme d’H3 au cours de la réplication, mécanisme programmé et disruptif pour l’épigénome ou (ii) suite à des dommages à l’ADN, événement disruptif non programmé pour l’épigénome. Les résultats générés par ce projet « Etoiles montantes » poseront les fondements d’un modèle permettant une compréhension plus globale des mécanismes permettant le contrôle de l’épigénome au cours du cycle cellulaire, qui seront l’objet du futur projet ERC.
-
En savoir plus : Estelle LEBEGUE
-
Subvention régionale : 130 000 €
-
Projet : e-NANOBIO - Electrochimie des nano-impacts individuels pour la détection bactérienne
-
Résumé : Le projet e-NANOBIO vise à concevoir un biocapteur à haute sensibilité et sélectivité basé sur l'électrochimie des nano-impacts individuels sur ultramicroélectrode (UME) pour détecter et identifier diverses souches bactériennes. S'appuyant sur l’expertise forte de la candidate Estelle Lebègue, l'enjeu d'e-NANOBIO est d'explorer en profondeur pour la première fois, la sélectivité de la méthode des collisions électrochimiques uniques pour différentes cellules bactériennes. L'objectif principal est d'établir une signature électrochimique unique et propre à chaque cellule bactérienne à travers le signal d'événement d'impact individuel à la surface de l’UME. Dans un premier temps, l’étude de bactéries Gram-négatives modèles (Escherichia coli, Shewanella oneidensis et Geobacter sulfurreducens) dans différentes conditions expérimentales (polarisation de l’UME, pH et concentration de la solution, présence d’une sonde redox) sera effectuée par l’électrochimie des nano-impacts individuels (Tâche 1). Pour pouvoir identifier le type de cellule bactérienne frappant la surface de l'UME, une fonctionnalisation adaptée (greffage covalent via la réduction des sels d’aryles diazonium) avec des espèces (bio)chimiques d'affinité appropriées telles que des anticorps ou des aptamères sera réalisée afin de conférer à la surface de l’UME une sélectivité du signal généré lors des nano-impacts individuels (Tâche 2). Ces objectifs scientifiques font d'e-NANOBIO une nouvelle voie ambitieuse pour le domaine de l'électrochimie des nano-impacts individuels, ce qui permettra d'identifier la candidate comme une experte mondiale de cette stratégie à des fins de biocapteurs appliqués par la suite à la détection d’agents pathogènes.
-
En savoir plus : Lise BOUSSEMART
-
Subvention régionale : 105 289 €
-
Projet : HELIOPREDICT - Génération d'un algorithme d'intelligence artificielle basé sur l'analyse de l'héliodermie péri-cicatricielle de mélanome, comme facteur prédictif de réponse aux anti PD-1
-
Résumé : Ces dernières années, l’immunothérapie par anti PD-1 a été démontrée efficace dans le traitement du mélanome de stade avancé, car les mélanomes, réputés secondaires à l’exposition aux rayons ultra-violets (UV) mutagènes, sont souvent porteurs d’une forte charge mutationnelle (TMB : nombre de mutations non synonymes par mégabase d’ADN), responsable de la génération de multiples néo-épitopes et donc d’une forte immunogénicité. Ainsi, une forte charge mutationnelle est corrélée à de meilleurs taux de réponse aux anti PD-1, mais tous les mélanomes ne sont manifestement pas dus au soleil, comme les mélanomes plantaires, génitaux,... Pour les autres, le rôle inducteur des UV varie selon le mode de vie et les habitudes d’exposition parfois anciennes des patients. Malheureusement la mesure du TMB n’est pas accessible à tous, en raison de son coût et des technologies qu’elle requiert. En l’absence de technique standardisée, il n’existe pas non plus de valeur seuil de réponse.
Ce projet est né de l’observation que j’ai faite au contact de mes patients, que le TMB mesurable dans l’ADN semble lisible sur la peau des patients, autour de la cicatrice du mélanome primitif. En effet, alors que la peau d’un nouveau-né est uniforme, les dommages causés par les UV laissent des stigmates clairement visibles, appelés « héliodermie », comme en témoigne souvent la différence phénotypique croissante d’avec l’âge entre peau des épaules et des fesses par exemple. Cette héliodermie est très variable car résulte des dommages solaires accumulées sur une vie, plus ou moins corrigés par une capacité individuelle à réparer l’ADN.
Pour aider le clinicien dans la mesure objective de ce marqueur clinique prédictif de réponse aux anti-PD-1, je propose de créer un algorithme d’intelligence artificielle basé sur l’analyse de photographies d’héliodermie péri-cicatricielle de mélanome primitif, tout en explorant sur le plan moléculaire le lien entre cette héliodermie et le profil de réponse aux anti PD-1.
- En savoir plus : François DELAVAT
- Subvention régionale : 125 400 €
- Projet : SMIDIDI - Socio-Microbiologie et Interactions Bactéries-DIatomées : Étude du comportement social et de l’hétérogénéité phénotypique des bactéries au sein de la phycosphère des Diatomées
- Résumé : Quand on pense au comportement social, on pense souvent à certains animaux comme les abeilles ou les fourmis. Au sein de leurs colonies, chaque individu aura une tâche à accomplir, qui sera différente de celle d’un autre individu. C’est cette répartition des tâches qui va permettre à la colonie de fonctionner correctement et de se développer.
Tandis que ce comportement social est très connu chez certains animaux, je m’intéresse à un monde peu exploré : celui des bactéries.
Est-ce que ces organismes unicellulaires et microscopiques sont également capables d’adopter un comportement social ?
Pour répondre à ces questions, je vais m’intéresser à des bactéries qui vivent en interaction avec un autre micro-organisme, une diatomée marine qui est une micro-algue très présente dans les milieux aquatiques.
Le but de ce projet sera de voir si, lorsque les bactéries vivent à proximité immédiate de la diatomée, celles-ci vont adopter un comportement social, avec une répartition des tâches.
Je vais donc tester l’hypothèse selon laquelle ces bactéries vont interagir entres elles et avec la diatomée, afin d’optimiser certains processus moléculaires, de sorte que diatomées et bactéries puissent se développer de façon optimale.
Pour mener à bien ce projet, j’utiliserai une approche de microscopie à épi-fluorescence, qui va me permettre de visualiser et de caractériser le comportement bactérien à l’échelle de la cellule unique.
Les résultats qui découleront de ce projet pourront avoir un impact très important sur la compréhension de la biologie de ces bactéries, et plus encore sur les cycles du carbone et de l’azote dans les océans car les bactéries au même titre que les diatomées participent à la transformation de ces éléments importants à la vie.
- En savoir plus : Matthieu PERRIN
- Subvention régionale : 83 400 €
- Projet : BROCCOLI, A BROadCast viewpoint for distributed COmputabiLIty
- Résumé : Imaginez que vous vous lancez dans la vente en lignes d'œuvres d'art. Vous devrez commencer par créer un site Web hébergé sur un serveur auquel vos clients se connecteront pour vendre ou acheter des articles. Cependant, cette solution montrera ses limites quand votre commerce prospérera : vous devrez répliquer votre site sur plusieurs serveurs, dans plusieurs pays, pour servir sans délai un nombre croissant de clients, y compris à l'étranger, même si l'un des serveurs tombe en panne.
Un nouveau problème se pose alors : lorsque que deux clients se connectent, chacun sur leur serveur, pour acheter la même œuvre, ceux-ci doivent absolument se synchroniser pour éviter de vendre l'article deux fois ! La solution traditionnelle utilise un protocole de diffusion atomique. À chaque tentative d'achat, un serveur envoie un message aux autres serveurs. Le protocole garantit que tous les serveurs reçoivent tous les messages dans le même ordre. Le premier message reçu décide quel client aura l'article.
Hélas, l'accord sur l'ordre des messages est l'un des problèmes de synchronisation les plus difficiles connus et pose une limite à la résistance aux pannes. De plus, une telle garantie n'est pas toujours nécessaire. Par exemple pour l'ordre entre les mises en vente : comment alors affaiblir les propriétés d'ordre sur les messages sans compromettre l'expérience utilisateur, pour une meilleure efficacité ou tolérance aux pannes ?
Ce projet cherche à mieux comprendre les différentes propriétés qui peuvent être garanties sur la diffusion de messages, et dans quels cas elles peuvent être utilisées.
- En savoir plus : Aracéli TURMO
- Subvention régionale : 71 500 €
- Projet : COSJE, La constructions de standards judiciaires européens
- Résumé : A mesure que l’intégration européenne progresse et que les États membres de l’Union européenne se lancent dans des coopérations poussées dans des domaines de plus en plus sensibles, tels que le droit pénal, ce projet vise à étudier les effets de cette intégration sur les juridictions.
Les juges jouent un rôle essentiel pour garantir l’efficacité des règles adoptées en commun à l’échelle européenne. En outre, la volonté de garantir un niveau similaire de protection des droits de l’Homme et de l’État de droit dans tous les États membres de l’Union nécessite un certain contrôle des juridictions par les institutions européennes et l’établissement de règles communes. Les juges sont de ce fait soumis à des exigences posées à l’échelle européenne, par exemple en ce qui concerne les conditions de l’accès au juge ou les droits des victimes et des accusés dans le procès pénal. On leur demande de collaborer avec des autorités d’autres États membres, par exemple dans le cadre du mandat d’arrêt européen. Tout ceci conduit à un établissement progressif de ce que l’on peut appeler un droit processuel européen.
L’objectif du projet sera d’étudier l’impact réel de ce phénomène sur le travail des juges dans différents États européens et de déterminer si les standards développés à l’échelle européenne sont suffisants au regard des ambitions de l’intégration européenne, en particulier en droit pénal.
- En savoir plus : Julien MASBOU laboratoire Subatech
- Subvention régionale : 129 900€
- Projet : SORBBET, StORage for Double BETa with xenon
- Résumé : Mes travaux de recherche, c’est comme jouer à « Où est Charlie » sauf que Charlie est une particule. J’étudie principalement les neutrinos et les particules de matière noire. Elles sont extrêmement intéressantes à observer car elles permettraient d’élucider deux grands mystères de l’Univers :
- L’Univers est constitué de particules et quand on pèse l’Univers (oui, oui, c’est possible !), on s’aperçoit qu’on ne connaît que 20% des particules qui le composent. Mais alors qu’est-ce qui constitue les 80% restants ? On pense qu’il s’agit de nouveaux « Charlie », c’est à dire des particules de matière noire.
- Nous savons également qu’au moment de sa naissance, l’Univers a créé autant de particules de matière que de particules d’antimatière (sa sœur jumelle). Pourtant aujourd’hui cette dernière a complètement disparu ! Les propriétés de mes « Charlie », les neutrinos, pourraient l’expliquer.Pour nous aider à trouver ces Charlie, nous nous servons du Xénon, un gaz rare que nous utilisons sous forme liquide. Pourquoi ? Parce que lorsqu’une particule décide de jouer au billard sur l’atome de Xénon, celui-ci émet un peu de lumière et un petit courant électrique. C’est donc très pratique pour savoir que le Xénon a été dérangé ! Nos Charlie vont donc eux aussi déranger le Xénon en provoquant des signatures caractéristiques qui leur sont propres. C’est ce qui les distinguera de toute la foule de particules qu’il y a autour de lui et qui peuvent lui ressembler (par exemple : un adulte en bonne santé de 70kg émet chaque seconde 8000 particules, mais qui ne sont pas nos Charlie !).
Enfin, afin d’assurer que cette expérience fonctionne, il faut mettre en place un espace de stockage adapté pour le Xénon. C’est un autre point essentiel de mon projet de recherche et nous l’avons appelé RestoX.
- En savoir plus : Mohamad EL HAJ
- Subvention régionale : 85 000 €
- Projet : EMAM - Evaluation des troubles de la mémoire autobiographique dans la maladie d'Alzheimer à travers l'étude des mouvements oculaires
- Résumé : Notre projet vise à proposer, pour la première fois, une évaluation physiologique du rappel autobiographique dans la maladie d’Alzheimer. Plus spécifiquement, nous souhaitons évaluer la nature des mouvements oculaires qui pourraient être activés lors de l’évocation autobiographique chez les patients.
- En savoir plus : Lénaïc LARTIGUE
- Subvention régionale : 151 500 €
- Projet : SUPERFERATITE - Nanoassemblages superferrimagnétiques pour un double traitement de l’hépatite auto-immune
- Résumé : Le système immunitaire est notre défense contre les attaques extérieures. Mais, parfois, ces soldats se retournent contre leurs propres troupes. On parle alors de maladie auto-immune. Ici, nous nous intéressons à la pathologie qui affecte le foie : l’hépatite auto-immune. Mais aucun traitement spécifique n’existe à l’heure actuelle.
- En savoir plus : Sylvain DUFRAISSE
- Subvention régionale : 107 520 €
- Projet : SPORTNAOUKA - L’influence soviétique et russe dans le milieu sportif contemporain (institutions, sciences, règlements, techniques)
- Résumé : Mon projet étudiera la fabrication des normes et des pratiques internationales, à partir du cas du sport de haut niveau.
L’objectif est de mieux comprendre comment se construisent les normes internationales en tenant compte de la parole de différents types d’acteurs : CIO, fédérations, agences, sociétés savantes ; questions qui se poseront encore dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques à Paris.